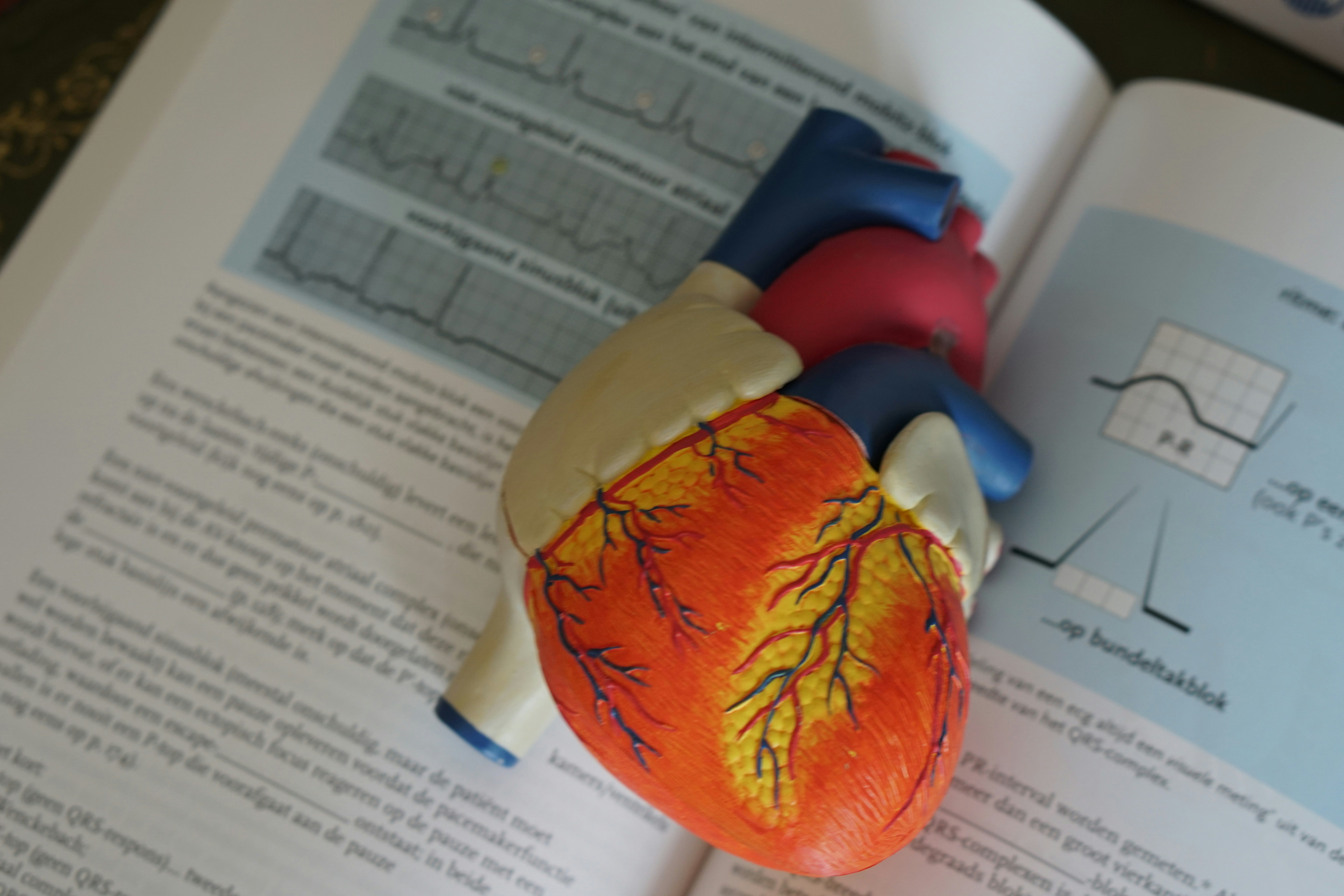Un enjeu sociétal à prendre à coeur
L’insuffisance cardiaque est aujourd’hui la première cause d’hospitalisation chez les plus de 65 ans. Une pathologie chronique qui mobilise les équipes soignantes (cardiologue, rythmologue, infirmières) au quotidien et qui représente un véritable enjeu de santé publique.
Face à cette réalité, la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque s’impose comme une solution concrète et efficace. Elle permet un suivi régulier et à distance des patients, grâce à la transmission de plusieurs données de santé (poids, tension, fréquence cardiaque, symptômes…). Les bénéfices sont désormais bien documentés : moins de jours d’hospitalisation et une diminution de la mortalité totale de 30 %*.
Reste une question essentielle : comment se lancer ?
1. Définir le cadre et les objectifs
La première étape consiste à définir précisément le périmètre médical du projet et ses objectifs. Il s’agit d’identifier les patients éligibles à la télésurveillance, de déterminer les critères de suivi et les indicateurs à observer, comme le nombre de jours d’hospitalisation évitables ou l’évolution des symptômes.
Cette phase de cadrage doit s’appuyer sur les référentiels de la HAS et sur le droit commun de la télésurveillance, entré en vigueur en 2023.
Poser ce cadre dès le départ permet d’assurer la cohérence du projet et d’en mesurer l’impact dans la durée.
2. Choisir la bonne solution de télésurveillance
Une fois les objectifs posés, le choix de la solution technique devient déterminant. Elle doit être à la fois simple d’utilisation, sécurisée et interopérable avec les outils déjà utilisés par les professionnels de santé. La plateforme doit être certifiée en tant que dispositif médical, garantir un hébergement des données de santé (HDS) conforme et respecter les exigences du RGPD et de l’ANS.
Mais au-delà de la conformité, l’expérience utilisateur est essentielle : une interface claire, adaptée aux patients comme aux équipes médicales, favorise l’adhésion et la régularité des transmissions. Les solutions multiparamétriques, qui permettent de suivre simultanément plusieurs paramètres depuis les données cliniques, biologiques, symptomatiques, et même pour certaines les données issues de prothèses implantées. Ces solutions, offrent une vision complète de l’état de santé du patient et facilitent la détection précoce des décompensations, afin de permettre une prise en charge médicale à distance du patient, allant jusqu’à la télétitration.
3. Organiser le parcours patient
La réussite d’un programme de télésurveillance repose avant tout sur la coordination des acteurs. Il est important d’impliquer dès le départ les cardiologues, les infirmiers, les médecins traitants et, plus largement, l’équipe de soins qui suit le patient au quotidien.
Chaque acteur doit connaître son rôle : qui reçoit les alertes, qui contacte le patient en cas d’anomalie, qui assure le suivi thérapeutique ?
Une organisation claire des responsabilités et un protocole bien établi évitent les doublons et garantissent un suivi réactif et homogène. Cette coordination crée aussi une relation de confiance entre les soignants et les patients, qui se sentent mieux accompagnés malgré la distance.
4. Former et accompagner les équipes
La télésurveillance n’est pas seulement une question de technologie : c’est aussi un changement de pratique. Former les professionnels à l’utilisation de la plateforme, à l’interprétation des données et à la gestion des alertes est essentiel pour que le dispositif soit réellement efficace.
Côté patient, un accompagnement pédagogique est également nécessaire. Comprendre pourquoi et comment transmettre ses mesures, savoir réagir en cas d’alerte, se sentir soutenu : autant de conditions qui favorisent la confiance et l’observance.
Des supports simples — fiches pratiques, tutoriels, vidéos courtes — peuvent aider à renforcer cette appropriation, tant pour les équipes que pour les patients.
5. Assurer le financement et la pérennité
Depuis 2023, la télésurveillance bénéficie d’un cadre de financement pérenne par l’Assurance Maladie, avec des forfaits destinés aux professionnels de santé et aux opérateurs techniques. Avant de se lancer, il convient de vérifier l’éligibilité du programme et d’identifier le modèle économique adapté à la structure concernée : établissement hospitalier, maison de santé, cabinet libéral, etc.
Certaines Agences Régionales de Santé (ARS) ou GRADES soutiennent également le déploiement de ces dispositifs par le biais d’appels à projets ou de financements complémentaires. Suivre les indicateurs d’activité et de performance dès le lancement du projet est un moyen de démontrer sa valeur médicale et économique, et donc d’en garantir la pérennité.
6. Mesurer l’impact et valoriser les résultats
Une fois la télésurveillance en place, il est indispensable d’en évaluer les effets concrets. La réduction du nombre d’hospitalisations évitables, l’amélioration de la qualité de vie des patients et la satisfaction des professionnels sont autant d’indicateurs à suivre.
Ces retours d’expérience constituent aussi une ressource précieuse pour d’autres établissements ou équipes souhaitant se lancer. Les valoriser — à travers des témoignages, des publications ou des échanges entre pairs — contribue à faire progresser la culture de la télésurveillance et à en renforcer la légitimité au sein du parcours de soins.
En résumé, mettre en place un programme de télésurveillance, c’est avant tout construire une organisation humaine autour d’un outil technologique. C’est un engagement collectif, fondé sur la confiance, la rigueur et la volonté d’améliorer le quotidien des patients chroniques. Et si la technologie est un levier, le véritable moteur du changement reste la collaboration entre les acteurs de santé.
* – Koehler F. et al., Efficacy of telemedical interventional management in patients with heart failure (TIM-HF2): a randomised, controlled, parallel-group, unmasked trial, The Lancet, Sept. 2018